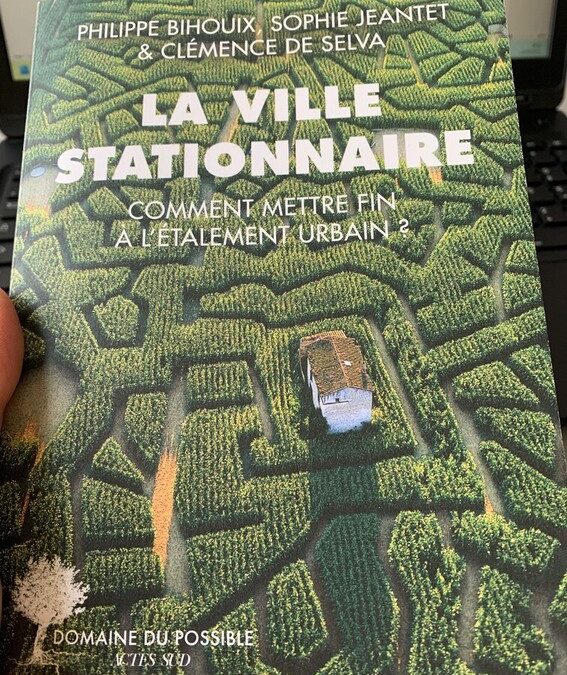La ZAN (Zéro Artificialisation Nette) fait couler beaucoup d’encre depuis son introduction dans la loi Climat et Résilience du 22/08/2021. Elle implique de réduire de manière significative la vitesse à laquelle les sols sont artificialisés. Mais est-celle seulement possible ? Et si oui, comment ?
Les textes en italique de couleur bleue sont directement issus du livre La Ville Stationnaire Comment mettre fin à l’étalement urbain, co-écrit par Philippe Bihouix, Sophie Jeantet et Clémence de Selva (Actes Sud, 2022).
Nous étions 34 millions en 1840. Nous sommes 65 millions aujourd’hui. La population a donc été multipliée par 2 sur cette période. L’espace que nous « occupons » (routes, constructions, infrastructures diverses, etc.) a quant à lui fait x9 sur le même intervalle de temps. Autrement dit, nous sommes 2 fois plus et occupons 9 fois plus d‘espace…
Depuis le début des années 1980, les sols artificialisés ont progressé entre trois et quatre fois plus vite que la population. C’est la définition même de l’étalement urbain, une « extension urbaine qui se fait plus rapide que la croissance démographique ».
Prise de conscience et premières réflexions
Quelques premières réflexions sur la question de l’étalement urbain apparaissent dans les années 1950 aux Etats-Unis. La France suit avec quelque décalage l’évolution outre-Atlantique de la motorisation des ménages, de la course aux supermarchés et du rêve pavillonnaire avec jardin pour tous.
Au début des années 90, les préoccupations environnementales montent en puissance (premier rapport du GIEC en 1990, sommet de la terre en 1992 à Rio). La ville dense, compacte, devient le nouvel horizon des politiques environnementales et de l’urbanisme. Progressivement, au cours de la décennie 2000, la densité et la densification sont érigées en solution incontournable et désirable. La ville dense permettrait de fonctionner de manière plus efficace, de rationaliser l’usage des ressources, de mutualiser des services tout en offrant des opportunités économiques, sociales et culturelles plus importantes à ses habitants.
La densification, une solution miracle ?
La densification permet de consommer moins d’espace, ce qui ne peut être que vertueux du point de vue environnemental, et on aurait intérêt à densifier le plus possible, du moins jusqu’aux limites socialement acceptables. Qu’en est-il des matériaux et de l’énergie que les bâtiments incorporent ? La densité apporte-t-elle un gain de ce point de vue aussi ?
En glissant vers la ville « hyperdense », quartier d’affaires ou immeubles de logements trop hauts et / ou trop concentrés, de nouvelles contraintes apparaissent : sur les réseaux techniques, sur les équipements, sur les flux physiques de personnes et de marchandises, sur les dispositifs de transports en commun… Le gigantisme des villes crée des besoins en infrastructures démesurés et complexes…
La densification, au-delà d’un certain seuil, ne semble donc pas réunir les atours de la ville sobre et écologique. Surtout quand on inclut les énergies grises, c’est-à-dire invisibles, associées à ce gigantisme. Mais qu’en est-il du paramètre « surface artificialisée », si tant est qu’on puisse l’isoler ?
Certes, les ménages de l’hyper-centre sont dans l’absolu moins « consommateurs de m² » pour leur habitat et les fonctions immédiates liées à leurs activités sociales. Mais il faut bien installer quelque part les « espaces servants » de la ville, techniques, logistiques, commerciaux, industriels, culturels, qui sont déportés à l’extérieur de la ville dense et conquièrent son « arrière-pays ». Les citoyens hyper-urbains prennent peu de place mais mobilisent des m² à l’extérieur par leur profil de consommation.
Pas évident non plus, donc, de se prononcer sur l’intérêt de la densification au regard de l’emprise au sol totale artificialisée.
Par ailleurs, la ville dense permettrait de réduire la quantité de déplacements de ses habitants. L’enquête Mobilité et modes de vie du Forum Vies Mobiles semble montrer qu’il y a un optimum et non une relation linéaire entre densité et quantité de déplacements : c’est dans les villes de taille moyenne, entre 10000 et 50000 habitants, que les temps et les distances de déplacement sont les plus courts à structure sociodémographique égale.
Ecolo la smart city ?
La complexité et la variété des objets électroniques, la multiplicité des composants et des matières incorporées, les quantités très faibles utilisées (et ce d’autant plus que l’objet est petit), les alliages employés, rendent les processus de recyclage littéralement cauchemardesques, et très imparfaits : actuellement, plus d’une trentaine de métaux (sur une soixantaine au total), souvent emblématiques des high-tech – comme l’indium, la gallium et le germanium, les terres rares, le tantale – sont recyclés à moins de 1% au niveau mondial. Compte tenu de la complexité des objets, de leur diversité, de leur évolution technologique permanente et particulièrement rapide, ces taux ne peuvent que très difficilement augmenter.
La ZAN à la rescousse
Nous artificialisons trop. Trop vite. Or, artificialiser un sol à de nombreuses conséquences : érosion de la biodiversité, aggravation des risques de ruissellement et d’inondation, relargage du carbone stocké dans le sol, augmentation des coûts des équipements publics (routes, électricité, assainissement), augmentation des temps de déplacement du fait de l’étalement urbain, perte de souveraineté alimentaire car 80% sols artificialisés sont des terres agricoles…
Ces problématiques sont connues et dans les tuyaux législatifs depuis un certain temps. Loi SRU (2000), Loi Grenelle 2 (2010), Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (2010), loi Alur (2014), Loi NOTRe (2015), Loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016), autant de textes qui viennent réaffirmer à leur manière les objectifs d’économie des sols. Mais force est de constater que depuis 2000, la seule chose qui ait significativement contraint l’étalement urbain est la crise de 2008. Le dernier texte en date est la Loi climat et résilience du 22/08/2021, qui introduit notamment l’objectif de « zéro artificialisation nette », ou ZAN, en 2050, avec un objectif intermédiaire de -50% dans les dix prochaines années (2021-2031 en référence à 2011-2021).
L’artificialisation concerne la quasi-totalité des communes. Seules 748 d’entre elles (soit 2.1%) n’ont pas consommé d’espaces entre 2009 et 2019. L’inverse de l’artificialisation, la renaturation, n’est quasiment pas constatée aujourd’hui. Pourtant, c’est bien d’elle dont il est question quand on parle de ZAN.
Le grand principe de la ZAN : la compensation
La ZAN relève en effet d’une logique de compensation : l’artificialisation d’une zone naturelle, agricole ou forestière doit être compensée par la remise à l’état naturel d’un terrain déjà considéré comme artificialisé, notamment par un processus de renaturation.
Même si le code l’environnement impose que les mesures soient effectives pendant toute la durée des atteintes, reste la question de la tenue et de la garantie dans le temps du dispositif de compensation écologique. Celui autorise à détruire maintenant, tandis que les mesures compensatoires qui dépendent d’un processus biologique plus long, prendront effet plus tard, sans garantie que cela fonctionne réellement et sans garantie de pérennité, car les nouveaux milieux « naturels » nécessiteront souvent des dizaines d’années (ou plus) d’intervention humaine (suivi, gestion, etc.) et la question de la responsabilité de la bonne exécution dans le temps de ces mesures par le porteur de projet n’est pas résolue.
La ZAN ne vise pas une protection des espaces non artificialisés, mais un meilleur rendement de l’artificialisation (par la densification notamment), couplé à des dispositifs de compensation et de renaturation.
La renaturation
Dans renaturation, il y a nature. Il y a l’idée de ramener un sol artificialisé vers un état de pré-artificialisation. Un état naturel. Mais qu’est-ce qu’un état naturel au juste ? Comment le définit-on ? S’il s’agit de ramener le sol à un état préexistant, quel est-il ? Le sol de 1950 ou celui de 1800 ?
En plus, puisqu’il s’agit de processus longs (reprise de la végétation, reconstitution de la vie microbienne de sols, etc.), à quel moment considérer qu’il y a bien renaturation, au déclenchement du dispositif ou après un certain laps de temps ?
Même en réussissant à diviser par 10 – un tour de force, dans les conditions actuelles – le flux d’artificialisation, il faudrait encore trouver, de manière pérenne, plusieurs milliers d’hectares à renaturer chaque année ; où trouver ce stock ?
Reste enfin la question économique, encore plus épineuse. Qui prendra en charge les couts de renaturation ? La puissance publique, les opérateurs privés ? Les opérateurs rechignent déjà, on le comprend bien, à assumer les coûts de dépollution. Il est toujours plus simple et moins coûteux de s’installer et construire sur d’anciennes terres agricoles ; de même qu’il est toujours moins incertain de construire du neuf que se lancer dans une réhabilitation qui peut réserver quelques surprises techniques.
Et s’il fallait plutôt parler de ZAB ?
Résumons : la ZAN est, sur le papier, un objectif louable. Mais sa mise en œuvre effective s’avère pour le moins épineuse. Se mettre sur la trajectoire d’une réduction forte de terres consommées par l’urbanisation, puis d’une compensation résiduelle, sans toucher au volume de la construction, est un pari d’une incroyable complexité.
Côté réduction, il faudra réussir à densifier suffisamment malgré les aspirations certaines ou les résistances locales des populations, assumer ou faire machine arrière sur les « coups partis » des actuels documents d’urbanisme, faire face aux injonctions contradictoires entre densification et besoin de « respiration » des villes, d’autant qu’elles sont plus grandes et étalées. Côté compensation, il faudra trouver un flux suffisant de terres à renaturer, et y faire fonctionner les mécanismes de restauration, du point de vue écologique et physique, mais aussi économique et réglementaire, alors que les processus naturels sont encore si mal connus, et que les dispositifs de compensation environnementale sont encore balbutiants et très, très loin d’avoir fait leurs preuves pour freiner, ou stopper, l’effondrement de la biodiversité.
Et si, au lieu de cibler une ZAN, c’était une ZAB, une zéro artificialisation brute, une zéro artificialisation « tout court » qu’il fallait mettre en œuvre ? Et que celle-ci serait beaucoup plus simple à atteindre en s’autorisant à remettre en cause les « besoins » de construction ?
Construire moins mais mieux
Il n’y a in fine que trois leviers pour limiter la consommation d’espaces en extension urbaines :
- Augmenter le taux de renouvellement urbain (la capacité à trouver des mètres carrés supplémentaires en ville sans consommer de nouveaux espaces)
- Augmenter la densité des opérations
- Diminuer la construction.
Et si on réfléchissait au dernier levier ? Si nous construisions moins ? En se servant du patrimoine bâti existant par exemple ? Le gisement est potentiellement énorme. Entre les logements vacants (3 millions) et les logements sous-occupés (environ 8 millions, à mettre en regard des logements sur-occupés, environ 1.5 millions), il y aurait de quoi loger quelques millions de personnes. Le problème, c’est que la majorité d’entre eux ne se situent pas là où sont les besoins.
Peut-être conviendrait-il alors de sortir de la logique de l’offre pour questionner les besoins. La production immobilière répond un impératif de rentabilité dans une situation de spéculation foncière. Les opérations restent assises sur des standards immobiliers « sans prise de risque » qui ne tiennent compte ni des évolutions sociétales, ni des besoins de mixité fonctionnelle, ni des enjeux de transition environnementale. L’offre se retrouve assez décorrélée des réels besoins. A la « campagne », les « plaques pavillonnaires » dopent par à-coups le croissance des villages et petits bourgs, et proposent également une offre standardisée à destination des familles, une population homogène qui vieillit en même temps… une fois les enfants partis, une ou deux décennies plus tard, il faut sauver l’école communale et donc construire de nouveaux lotissements… tandis que les personnes âgées habitent des logements et des jardins trop grands dont ils aimeraient parfois ne plus avoir à s’occuper. Pour optimiser et dynamiser les parcours résidentiels, et a qualité des logements, il faut diversifier (et adapter) le parc de logements et les modes d’habiter.
Mais chaque ville a ses contraintes. Son contexte propre. Et ces nouvelles dynamiques, souhaitables à bien des égards, vont mettre du temps à s’installer, d’autant qu’il faut qu’elles se substituent à d’autres déjà à l’œuvre qui présentent une grande inertie. Il faut faire du cas par cas. Naviguer au milieu d’injonctions contradictoires. Se creuser les méninges à plusieurs, acteurs du public et du privé, propriétaires terriens, …. Voir loin dans le temps. Pas évident…
Redistribuer à toutes les échelles
Réfléchir à comment construire moins n’est pas une mince affaire. Les pensées simplistes du type « hier on construisait X logements / an, demain on en construira X-10% » n’ont pas de sens. Les réflexions doivent s’intégrer dans un contexte beaucoup plus large allant au-delà des seuls secteurs de la construction ou de l’artificialisation. Elles doivent être beaucoup plus transversales. Beaucoup plus systémiques.
Une idée pour ralentir, stopper voire inverser les tendances d’artificialisation à l’œuvre serait de redistribuer à toutes les échelles.
A moins d’être rentier, le nerf de la guerre reste le travail : avant tous les autres paramètres (cadre de vie agréable, école pour les enfants, proximité des activités culturelles, etc.), on s‘installe dans une région parce qu’on a la possibilité d’y gagner sa vie. Les emplois publics oui mais ça reste une goutte d’eau par rapport au total. C’est donc un mouvement plus large, concernant toute l’activité économique, publique et privée, qu’il faudrait favoriser et accompagner. Comment peut-on passer à une échelle supérieure, qui puisse vraiment peser dans la balance et faciliter les objectifs de zéro artificialisation ? La puissance publique possède différents moyens d’action :
- Pouvoir législatif et réglementaire : rythme de réécriture des schémas directeurs régionaux, des SCOT puis des PLU à la vitesse des débats démocratiques, c’est-à-dire plutôt lentement, mais c’est ainsi…
- Pouvoir économique :
- Evolutions fiscales : taxer plus fortement, voire entièrement « collectiviser » les plus-values foncières sur les terres à artificialiser calmerait sans doute un certain nombre d’ardeurs autour des révisions de PLU ; à condition d’aider les agriculteurs qui comptent aujourd’hui sur les PLU pour prendre leur retraite.
- Par les achats de produits et services qu’ils effectuent, les cahiers des charges qu’ils émettent, les marchés et délégations qu’ils passent, les services de l’Etat peuvent faire émerger, soutenir, favoriser des filières économiques.
- Capacité d’exemplarité et d’entrainement : La « démétropolisation » de quelques services administratifs centraux en est un exemple. Une réflexion plus globale sur un nouvel aménagement du territoire ne serait-elle possible ? Ainsi par exemple des implantations des écoles supérieures et des universités, ou des paramétrages du logiciel Parcoursup…
Être plus systémique
Mais tout cela, peut-être, a-t-il vocation à ne rester que du bricolage si nous n’abordons pas les choses de façon plus radicale et systémique. Regardons les choses en face. A quoi pourrait ressembler, sans se mentir, cette France de 2050, ayant atteint à la fois la neutralité carbone et la zéro artificialisation nette ?
Dans la version « gentillette » d’une sirupeuse croissance verte, à peu près à la même chose qu’aujourd’hui : sur les routes, on circule plutôt en voiture électrique bien sûr, sur du bitume recyclé issu de l’économie circulaire ; dans les rues, on se balade plutôt sur divers artefacts de mobilité douce, ou on emprunte les transports en commun efficaces, silencieux et sans doute autonomes ; les maisons, les petits immeubles, sont bien isolés et couverts de panneaux solaires ; l’agriculture s’aide parfois de petits robots désherbants pour cultiver bio ; cette fois, on tri vraiment bien ses poubelles ! etc.
Quelle fable !
Quid de la profonde évolution des modes de vie, de la nécessaire réduction drastique de la consommation matérielle, de la profonde transformation de la structure agricole et industrielle que réclame ce monde « zéro carbone » ? Il ne s’agit pas de stigmatiser ces métiers du « numérique » parce que le numérique de 2050 y prendrait un peu moins de place qu’aujourd’hui-même si ce serait souhaitable… mais d’admettre – c’est l’éléphant dans la pièce – que l’essentiel de ces activités, presque toujours liées au marketing, ne peuvent exister sans une consommation matérielle phénoménale.
L’enjeu d’une redistribution de la population sur le territoire nous semble donc à articuler avec trois autres enjeux, de longue haleine, de la transition énergétique et environnementale :
- Celui d’une certaine « démobilité », en diminuant nos besoins de déplacements quotidiens, en rapprochant les zones d’emploi et d’activité des logements, en favorisant le maillage pour les mobilités actives, chemins, sentiers piétons, vélo-routes… ;
- Celui d’un retournement des tendances historiques de la productivité et de la machinisation agricole, pour faire muter notre système agricole vers des pratiques respectueuses du sol et du vivant, pour relocaliser une partie significative de l’alimentation et de la production agricole dans les territoires ;
- Celui d’une reterritorialisation, à différentes échelles, de certaines productions essentielles.
Sans une profonde refonte de nos modèles économiques, sociaux et culturels, la ZAN est impossible, de la même manière que le zéro émission nette est très certainement impossible sans cette même refonte.
Sources :
Aristide Athanassiadis – Chaine Youtube Metabolism of Cities : Comment mettre fin à l’étalemet urbain ? (Philippe Bihouix) https://www.youtube.com/watch?v=3r9OLYBRPAs
Livre : La ville stationnaire Comment mettre fin à l‘étalement urbain ? Philippe Bihouix, Sophie Jeantet & Clémence De Selva
Sylvain Grisot – Podcast dixit.nt : #62 Phlippe Bihouix, Clémence de Shelva et Sophie Jeantet – La ville stationnaire https://creators.spotify.com/pod/profile/dixitnet/episodes/62-Philippe-Bihouix–C-lmence-de-Selva-et-S-ophie-Jeantet–La-ville-stationnaire-e1qlodn
https://www.dixit.net/newsletter110/
https://gazetteducarbone.org/2025/04/22/la-gazette-du-carbone-semaine-16-15-avril-2025
Article rédigé uniquement avec ma tête, sans intelligence artificielle.